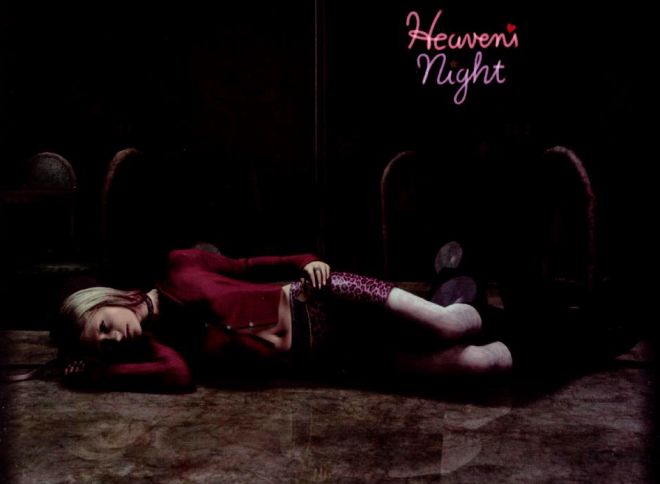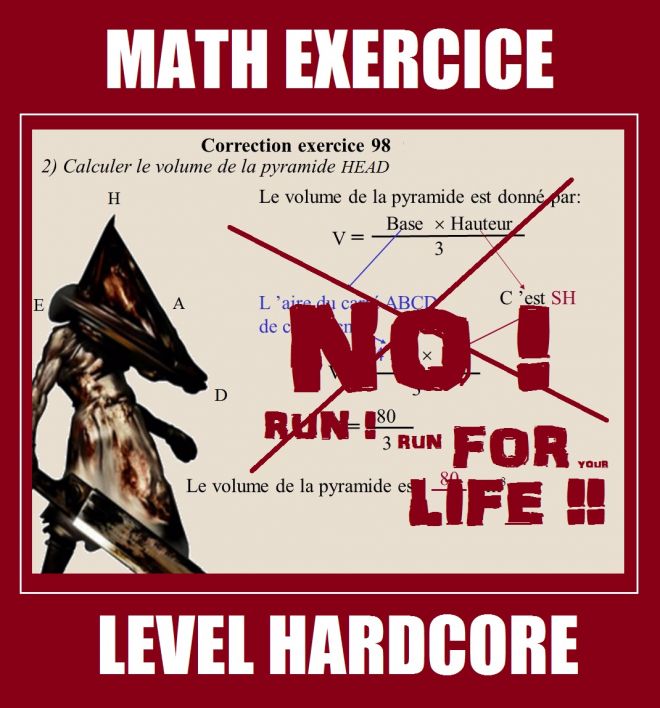In my restless dreams, I see that town : Silent Hill.
Ça fait près de 20 ans que ça dure.
Je suis tombé amoureux de la musique d'Akira Yamaoka bien avant de tomber amoureux de la ville elle-même, et autant dire que ça ne nous rajeunit pas.
Flashback : nous sommes en février 1999, à quelques mois de la fin du monde – ou, plus probablement, de la fin du millénaire et son grand bug de l'an 2000. Trois ans plus tôt, la sortie de la Playstation révolutionnait le champ très confidentiel et très décrié des jeux vidéo : les bits doublent, la 3D fait une apparition d'autant plus remarquée qu'elle est attendue de longue date (et si hideuse soit-elle, elle paraît à l'époque d'une beauté à couper le souffle), les soundtracks ressemblent enfin à de vrais morceaux joués par de vrais instruments, on apprend à sympathiser avec nos nouveaux (et envahissants) amis les temps de chargement. C'est une nouvelle ère qu'annonce, avec près d'une décennie d'avance, la console de Sony.
Le premier contact du public européen avec ce qui deviendra l'un des fers de lance du survival horror (et l'une des sagas les plus cultes du microcosme vidéoludique) a lieu presque à la dérobée, en cachette, comme au fond d'une de ces impasses mal famées qu'on y trouve à chaque coin de rue. Car c'est dans la boîte d'un autre titre appelé à la consécration, Metal Gear Solid, que les heureux acheteurs découvrent un mystérieux CD Demo bonus, proposant un trailer cinématique et un segment jouable (l'école), dans sa version non-censurée.
(crédits : Wallpaper by Jezzy54)
N'ayant à l'époque ni la console en question (je la gagnerai à un tirage au sort près d'un an plus tard), ni de goût particulier pour les univers militaires, ni la patience nécessaire pour prendre plaisir à jouer à un jeu d'infiltration, je n'ai jamais laissé mes amis s’appesantir sur le sujet, préférant leur demander de me repasser la cinématique de ce fameux CD démo, encore, et encore, et encore (j'ai perdu beaucoup d'amis, à l'époque, je ne me l'explique pas). Une séquence cryptique de 3 minutes, à la fois sombre, étrange, captivante et montée avec soin, qui n'a cessé de me hanter ensuite, de jour comme de nuit, et de nourrir mon imaginaire. La faute à ses images, aussi belles que dérangeantes, comme on n'en avait jamais vu jusqu'alors dans ce champs d'expression (de par leur parenté avec le cinéma, ou par la densité scénaristique qu'elles semblaient promettre - à juste titre) - et tout particulièrement cette séquence sur la route, pourtant anecdotique, lorsque la moto dépasse le véhicule du protagoniste, l'effet de vitesse donnant à l'obscurité une profondeur irréelle. Le visuel n'aurait sans doute pas semblé si fascinant, cependant, sans le thème musical unique qui l'accompagnait - dont la mélancolie, les envolées inattendues et les sonorités peu communes s'accordaient à merveille à sa clarté autant que ses ténèbres. A l'image (ou, dirons-nous, au son) de la série elle-même.
C'était hier encore.
De quoi exciter les neurones et faire tourner l'imagination en roue libre, se laisser happer tout entier, plaquer ses propres représentations sur l'un comme sur l'autre, y aller de ses propres spéculations quant à la nature véritable de l’œuvre, dans son fond comme dans sa forme, à la façon d'un test de Rorschach interactif.
Par la suite, chaque nouveau trailer aura apporté sa pierre à cet édifice fantasmatique personnel, sa touche de renoncement, de fureur et d'espoirs mêlés, m'attirant de plus en plus inexorablement vers cette ville mystérieuse aux rues encombrées de brouillard, ce Purgatoire numérique qu'on appelle Silent Hill.
Il faudra cependant des années de maturation avant que j'ose franchir le pas et mettre enfin un jeu derrière ces pitchs intrigants, ces screenshots malsains, ces thèmes musicaux hypnotiques que j'écoutais en boucle.
Des années à questionner, supposer, réinventer la saga jusqu'aux fondations, au rythme des percussions oppressantes d'Akira Yamaoka, ou de la voix ensorcelante (au sens mystique du terme) d'Elizabeth McGlynn. Des années à saisir les jeux dans les bacs de la Fnac, hésiter, les tourner et les retourner, les reposer, passer mon chemin.
L'un des nombreux guidebooks japonais dédiés à l'épisode 2.
Et puis un jour, n'y tenant plus, tant pis pour le macaron d'avertissement au dos de la boîte, j'ose, et c'est une révélation : après le J-RPG, le survival horror devient mon nouveau genre de prédilection, le type de produits vidéoludique le plus proche d'une expérience narrative de qualité (avant de péricliter à son tour - à cause de mécaniques trop exigeantes et peu adaptées au public moderne -, pour céder finalement la place aux walking simulators, qui sont tous peu ou prou les rejetons illégitimes de l'épisode 2).
Oui, je sais, il me manque l'épisode sur Gameboy Advance.
Ne remuez pas le couteau dans la plaie s'il vous plaît !
Moi qui, pourtant, ne supporte pas l'ombre d'un début de tripaille au cinéma, et qui fuit les films d'horreur comme la peste (Evil Dead 3, House 2 ou la Cabane dans les Bois représentant la limite de ce que je suis capable de supporter en la matière...), j'ai découvert qu'à quelques Project Zero près, ce genre ne m'effraie pas : il me stresse, me subjugue, me vide mais ne me terrorise pas, au contraire. Je ne rallume pas la lumière en fin de partie, je regarde les ténèbres en face et le sourire aux lèvres. De chaque session de jeu, je sors serein et apaisé. Pour tout dire, il fut même une époque où ils eurent temporairement raison de mes insomnies.
Il faut dire également que la saga Silent Hill représente un cas à part au sein des survival horror, préférant la suggestion, les silhouettes incompréhensibles et les ombres chinoises aux facilités de la sauce ketchup et de la bidoche Residentevilienne (qui a cependant le mérite d'avoir inventé le genre). Car si les jeux reposent sur les mêmes mécaniques, le public visé n'est pas le même. On le constate dès leurs séquences d'introduction. Alors que Resident Evil assume ouvertement son hommage aux films de série B (sans se douter qu'il deviendrait plus tard une triste référence en matière de série Z), Silent Hill se retrouve estampillée « série d'horreur » presque par accident - alors qu'il s'inscrit plutôt dans la lignée de films comme In the Mouth of Madness ou Cabal (dont il s'inspire énormément ; et ce n'est sans doute pas un hasard si le premier film de Silent Hill constitue l'une des meilleures adaptations de jeu vidéo à ce jour - malgré quelques fulgurances gore de mauvais goût, qui trahissent quelque peu l'esprit de l'oeuvre originelle ).
Un petit film plutôt sympathique, très inspiré de la saga :
sans grande originalité, ni vrais moment d'effrois, mais sincère juste ce qu'il faut.
Car si cette mystérieuse ville dans la brume est bel et bien peuplée d'amas de chair grouillants, informes et repoussants qu'il faut fuir, abattre ou aplatir à la barre à mine, à mon sens, son véritable propos est ailleurs. L'horreur, on le sait, y est psychologique plutôt que physique, intérieure plutôt qu'extérieure, et les images à l'écran n'en sont que la manifestation. Et si les quelques êtres humains (?) qu'on peut croiser en route, et qui nous égarent autant qu'ils nous guident, injectent un peu de vie dans cet univers figé entre la vie et la mort, l'enfer et le paradis, tôt ou tard, ils se révèlent aussi effrayants que les créatures tapies dans les ombres car plus instables, plus fêlés (au sens propre), plus imprévisibles, toujours à deux doigts de basculer dans la folie, à la fois victimes et bourreaux, anges et démons, meurtris et meurtriers.

La dimension horrifique de la saga ne serait finalement qu'un exutoire, un cadre quasi-psychothérapeutique (comme le suggère d'ailleurs l'épisode Shattered Memories), une sorte de régression hypnotique au sein de laquelle vont se matérialiser les ténèbres intimes de l'individu : toutes ces obsessions, névroses, cassures et dissociations qui jalonnent notre parcours tout au long de nos vies, les colères qui ne se sont jamais apaisées, les abus qui nous marquent d'une lettre écarlate, les mots qui nous blessent, les deuils que nous n'avons pas surmontés, tout ce qui nous empoisonne lentement et qui, sans que nous en ayons conscience, nous entraîne toujours un peu plus au bord de ce gouffre Nietzchéen qu'on nomme ici Silent Hill.
L'intégrale des comics parus à ce jour, lesquels prennent parfois trop de libertés sur le plan scénaristique, mais sont toujours remarquables sur le plan visuel (ce qui n'est pas rien).
Sous couvert de divertissement, la saga nous parle de notre condition d'être humain, à la fois fragile, futile, méprisable, dérangée, mais qui peut également confiner au grandiose, au sublime, au divin. Elle nous donne à voir comment les épreuves peuvent nous détruire, nous mettre en pièces, ou au contraire comment nous pouvons surmonter celles-ci jusqu'à renaître (en terme d'un douloureux voyage initiatique), comment la pureté peut survivre à la souillure, comment l'âme peut refleurir en plein désert.
Et c'est précisément ce que j'aime, dans Silent Hill : pas son bestiaire grotesque et repoussant, ses mannequins difformes, ses têtes-de-pyramides, ses infirmières sans visages, mais la façon dont il allume une torche dans les ténèbres, dont il renverse les perspectives et parvient à transfigurer l'horreur pour, au contraire, en extirper quelque chose de si pur et si lumineux qu'il en vient à faire mal, lorsque la rédemption transforme le cauchemar en victoire, et la rouille sur les murs en une illumination personnelle. A l'heure où les jeux vidéos sont encore, trop souvent, prétexte à « faire la guerre », Silent Hill, lui, nous parle de « faire la paix ». Avec les autres, présents ou disparus. Avec nous-mêmes. Pas de façon naïve ou propre-sur-elle. Pas en arrondissant les angles. Sans concession. Non sans violence, efforts, soubresauts de dégoût.
Or le génie d'Akira Yamaoka, justement, tient à la finesse avec laquelle il a compris ce sous-texte dès le premier épisode ; autant qu'à la justesse avec laquelle il a su le retranscrire à la note près, alternant les thèmes d'ambiance chaotiques, plus proche du bruitage que de la musique à proprement parler, et les morceaux « écorchés vifs » qui prennent aux tripes dès les premiers accords - comme autant de sursauts cathartiques et libérateurs (même si, avouons-le, à quelques pistes près, le premier CD peine à exister sans le support du jeu ; à l'opposé du troisième, qui offre au mélomane un concept-album aussi magnifique qu'inattendu – dont de nombreux thèmes et motifs rappellent le Outside de David Bowie, ce qui n'est pas peu dire).
Ajoutons à cela l’ambiguïté des paroles, souvent à double sens, nihilistes juste-ce-qu'il-faut, ou la voix tantôt claire, tantôt voilée (de brume) d'Elizabeth McGlynn, actrice-doubleuse-chanteuse américaine qui a marqué de son timbre toute l'industrie du jeu vidéo, et on comprendra que ce soit moins en fan de Silent Hill qu'en fan de ce duo hors-normes que j'ai pris la route hier soir, à la nuit tombée, avec le premier CD dans l'auto-radio, pour me rendre dans une mystérieuse petite ville de la banlieue Lyonnaise, où il se produisait dans le cadre de sa tournée mondiale.
Silence et rues désertes dès 19 heures, c'est dire si j'y étais déjà.

Merci pour ce moment, Wayo (et pour cet excellent boulot) <3
J'ignorais cependant que l'expérience se révèlerait aussi intense qu'une heure du jeu éponyme. Car calée sans chichis entre une date Parisienne et une date Toulousaine plus ambitieuses, et accueillie dans une toute petite salle à taille humaine, la session n'aura drainé que 250 à 300 personnes, tout au plus, au point de ressembler davantage à un concert privé VIP en carré d'or qu'à un show formaté de deux superstars internationales (j'écris deux, mais le reste du groupe - Matt Murdock, Israel Ullo et Laurent Duval – n'ont pas manqué de crever la scène, à défaut de crever l'écran).
D'accord, le Downpour n'a pas grand chose à faire là, mais Licht a été respectueux du travail de Yamaoka et a su tracer sa propre voie musicale, sans pour autant renier l'héritage de la série.
Rendez-vous compte : même sans jouer des coudes ou se presser comme des M&M's bleus au fond d'un sachet familial, il était possible de vivre le concert à trois mètres des artistes. Cinq, grand maximum. Avec les vibrations des baffles qui dansent sur le parquet jusqu'à sous vos semelles. Pouvait-on rêver meilleures conditions pour célébrer (avec un peu d'avance) ce vingtième anniversaire de mon histoire d'amour à sens unique ?
A sens unique, j'ai dit.
Difficile, bien sûr, de s'en réjouir tout à fait, et de ne pas avoir un pincement au cœur en pensant que ces grands artistes ont sans doute joué à perte, mais en dépit de cette audience restreinte, ils n'ont rien montré de leur déception et n'ont ni ménagé leur peine, ni coupé court, généreux jusqu'au bout du bout (pas moins de cinq rappels, dont une chanson « bonus » à la demande du public - « I want Love », excusez du peu), jouant comme ils l'auraient fait pour trois mille personnes, en « donnant tout, sans retenue » (comme on dit), sans économie d'arabesques vocales inédites ou de riff guitares orgasmiques, au point que les versions studio en paraissent presque trop sages, en comparaison (et pourtant, dieu sait qu'elles ne le sont pas).
Ainsi, dès les premières cordes grattées : les frissons. Des pieds à la tête. Qui ne cesseront d'aller et venir au fil d'une playslist parfaite, convoquant tous les titres les plus emblématiques de la saga (mention spéciale personnelle pour Hell Frozen Rain – mes cheveux longs ne m'ont jamais tant manqués que sur ce morceau, n'ayant hélas plus rien à secouer dans tous les sens depuis longtemps), ainsi que quelques surprises jubilatoires : un solo batterie halluciné (autant qu'hallucinant), une version « McGlynn » de Cradle Forest, quelques thèmes tirés d'autres pointures du jeux vidéo...
Alors que Yamaoka se fait d'une discrétion et d'une impassibilité toutes japonaises, mais semble ne faire qu'un avec sa guitare, comme possédé par sa propre musique (et nous rappelle brillamment « qui est le patron » sur trois instrumentaux incendiaires - dont les fameux theme of Laura et Promise, très attendus), McGlynn rayonne littéralement de charisme et capte tous les regards, interprétant les chansons au sens théâtral du terme, allant jusqu'à vivre physiquement ce Room of an Angel dont elle confesse qu'elle est « de loin sa préférée ».
Entre ses tentatives timides pour parler un français tâtonnant mais irrésistible, son humour bon enfant et son énergie communicative, impossible de ne pas tomber raide amoureux, quelle que soit la différence d'âge. Et alors que par nature, les titres auxquels elle prête sa voix sont noirs et plein de détresse, elle s'applique à en faire ressortir toute l'éclat pour véhiculer un message simple et fort, salutaire par les temps qui courent : « Feel Joy ! ».
Quelques menus souci de son n'auront rien gâché au tableau (malgré les récriminations bruyantes et regrettables de la part de quelques irréductibles buveurs de bière ne tenant manifestement pas l'alcool), renforçant l'impression d'un « petit concert » intimiste et improvisé, comme on aurait pu en écouter au Heaven's Night, loin des scènes des festivals geeks traditionnels.
Concert à l'image de Silent Hill elle-même, en somme : pas parfait, un peu « métallique », un peu organique dans ses sonorités, mais hors de l'espace et du temps, et magnifique jusque dans ses ratés et ses imperfections.
Horreur ! Le dernier CD du "maître" était déjà en rupture de stock ! Merci les Parisiens ! ;)
Au retour, CD du 3ème épisode à fond dans la voiture (oui, il me manque celui du 2, avis aux généreux donateurs), autoroute quasi-déserte avec d'entrée de jeu, cet affichage en lettres lumineuses : « Attention, danger : brouillard ». Comme si la météo elle-même était de la partie, pour estomper encore les frontières entre la fiction et la réalité.
Inévitablement, mes pensées se mettent à vagabonder.
Soudain, une silhouette.
Crissement de pneus.
Je sors de la route.
Mon aventure commence.
In my restless dreams, I see that town : Silent Hill.